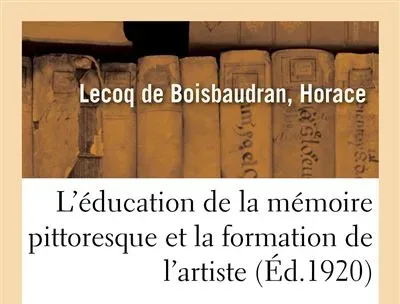Éducation de la mémoire pittoresque : un enseignement novateur du dessin au XIXe siècle
L’auteur : Horace Lecoq de Boisbaudran
Horace Lecoq de Boisbaudran (1802-1897) fut professeur à l’École impériale de dessin et au lycée Saint-Louis, puis directeur de l’École nationale de dessin. Figure majeure de la pédagogie artistique au XIXe siècle, il est aujourd’hui connu pour sa méthode centrée sur le développement de la mémoire visuelle appliquée aux arts du dessin.
Le but de l’ouvrage
Publié pour la première fois en 1847, puis enrichi et réédité en 1862, Éducation de la mémoire pittoresque répond à une lacune de l’enseignement artistique de son époque : l’absence totale de formation méthodique de la mémoire visuelle.
« Parmi les facultés intellectuelles mises en jeu par l’étude et la pratique des arts du dessin, la mémoire tient une place des plus importantes. Cependant cette faculté précieuse n’a été jusqu’ici l’objet d’aucune culture spéciale et méthodique.»
Lecoq s’adresse à un public de professeurs et d’élèves en art, mais aussi aux institutions et aux pédagogues.
Son objectif est clair : démontrer que la mémoire des formes et des couleurs peut être éduquée comme la mémoire verbale, par une méthode progressive et rigoureuse.
Il s’inscrit dans le contexte d’un enseignement artistique en mutation, au moment où l’État développe des écoles de dessin pour répondre aux besoins industriels.
Les grands axes pédagogiques
Trois principes structurent sa pensée :
La mémoire est une faculté perfectible, au même titre que la main ou l’œil.
La mémoire pittoresque est essentielle à la pratique du dessin, surtout pour saisir les mouvements fugaces, les effets atmosphériques, ou encore dessiner sans modèle.
Un entraînement progressif, comparable aux leçons apprises par cœur à l’école, permet de développer cette mémoire.
« Il ne s’agit donc ni d’un changement ni d’une perturbation, mais d’un complément et d’une annexe. »
Résumé détaillé de la première partie : Mémoire spéciale des formes
1. L’importance de la mémoire dans les arts visuels
L’auteur commence par souligner que la mémoire est fondamentale pour tous les artistes, en particulier pour représenter ce qui est fugace : nuages, animaux, lumière changeante. Ceux qui en sont naturellement dotés, comme Horace Vernet, ont un immense avantage ; mais pour les autres, elle peut (et doit) être développée.
« Le nom populaire de M. Horace Vernet se présente ici naturellement pour rappeler ce que la mémoire peut ajouter de puissance au talent. »
2. L’analogie avec les études littéraires
Comme l’élève en grammaire répète ses leçons, le dessinateur doit « apprendre par cœur » des formes visuelles, de plus en plus complexes. Lecoq propose une progression pédagogique méthodique, du simple au complexe.
« Le commençant doit donc apprendre par cœur et reproduire de mémoire les formes les plus simples, des lignes droites même pour s’exercer seulement d’abord au souvenir des grandeurs. »
3. La méthode pédagogique proposée
a. Leçons de mémoire visuelle (formes)
L’exercice type :
L’élève observe un modèle simple (ligne, courbe, profil).
Il le répète en pensée ou au crayon plusieurs fois.
Puis, sans le modèle sous les yeux, il le dessine de mémoire.
« L’élève dessinateur devra retracer son modèle par la main ou par la pensée le nombre de fois nécessaire pour pouvoir le reproduire de mémoire lorsqu’il lui sera retiré. »
Les premières formes étudiées :
Lignes droites (pour la mémoire des proportions)
Angles
Courbes
Détails anatomiques simples (ex : nez de profil)
Petites têtes avec coiffures et expressions
Le tout est organisé selon une gradation soigneuse de la difficulté.
b. Cadre de l’expérience pédagogique
Lecoq met en place une classe expérimentale de jeunes élèves (12-15 ans), sans sélection préalable sur leurs capacités mnémoniques. L’enseignement a lieu hors du cadre du cours de dessin classique. Il obtient l’adhésion volontaire des élèves, ce qu’il juge fondamental.
4. Retours d’élèves et observations
L’auteur note les propos des élèves, recueillis en cours d’exercice :
« Je vois mon modèle dans ma tête. »
« L’image me paraît confuse dans son ensemble, mais si j’applique toute mon attention seulement à un détail, cette partie devient assez distincte. »
Ces témoignages sont précieux pour comprendre la progression de l’apprentissage mnémonique.
5. Objections et réponses
Lecoq répond à plusieurs critiques prévisibles :
Risque de rigidité ou de « mémoire morte » ? Il répond que le but n’est pas de copier mécaniquement, mais d’exercer l’intelligence par l’observation active.
Perte de spontanéité ? Non, la mémoire bien formée devient un outil au service de l’imagination.
Menace pour le style personnel ? La mémoire formée à la variété des formes naturelles favorise, au contraire, la richesse du style.
« Ce doit être une faculté de plus. »
6. Applications au-delà de l’art
Lecoq montre l’utilité de cette mémoire dans :
Les industries artistiques : décoration, textile, bronzes, papiers peints.
Les sciences naturelles : zoologie, botanique, minéralogie.
L’éducation générale : la mémoire des formes développe l’observation, le goût, l’intelligence visuelle.
« Par l’étude généralisée du dessin perfectionnant désormais la mémoire et l’observation, on répandrait le goût des arts. »
7. Lien avec l’imagination et l’idéal
Dans les dernières pages, Lecoq insiste sur la fonction créatrice de la mémoire. L’artiste dont la mémoire est bien éduquée peut puiser dans un riche répertoire visuel personnel.
« Un voyage, un site, un beau ciel, des groupes, une attitude, des monuments […] seraient par lui conservés comme en un dépôt sûr. »
Il ouvre même une piste philosophique : les idées seraient des images mémorielles combinées par l’imagination, d’où l’importance de leur clarté et de leur richesse.
Résumé de la deuxième partie Mémoire spéciale de la couleur
Une mémoire à part entière
Après avoir exploré la mémoire des formes, Lecoq de Boisbaudran consacre un second chapitre à un sujet encore plus négligé dans l’enseignement artistique : la mémoire de la couleur.
Il affirme d’emblée qu’elle mérite une éducation distincte et méthodique, à l’image de celle des formes :
« L’éducation de la mémoire pittoresque comprend dans sa généralité la mémoire des formes et celle des couleurs, mais sans les confondre. »
Une méthode progressive, inspirée du dessin de mémoire
Lecoq élabore une série d’exercices progressifs, sur le même principe que pour les formes : apprendre par cœur des modèles, puis les reproduire de mémoire au pinceau, sans modèle sous les yeux.
Exercice type :
Observer deux teintes simples sur fond neutre.
Les mémoriser.
Les reproduire sur une feuille identique, à la peinture à l’huile, pour garantir la précision du rendu.
« Le premier de ces modèles offrait la plus simple combinaison possible : deux teintes plates placées l’une à côté de l’autre. »
Puis, progressivement :
trois couleurs,
des nuances plus subtiles,
des combinaisons complexes.
Public et organisation
Ces exercices ont été menés en dehors du cadre de l’École impériale (qui n’enseignait pas la peinture), avec des jeunes gens n’ayant jamais pratiqué la couleur. Lecoq souligne leur sérieux et leur progression :
« Tous sont parvenus à apprendre par cœur et à réciter, pour ainsi dire, au pinceau, avec une fidélité scrupuleuse, ces images colorées, sans formes qui puissent aider le souvenir. »
Deux facultés distinctes
Il note que la mémoire des couleurs et celle des formes ne sont pas toujours réunies chez un même individu :
« J’ai trouvé bien peu de sujets qui réunissent au même degré ces deux sortes d’aptitudes. »
Mais il observe que l’entraînement permet de rééquilibrer ces facultés, et même de corriger certaines aberrations naturelles (tendance à voir tout en gris, en jaune, etc.).
Objectif pédagogique : préparer à la peinture
L’auteur critique le fait que l’on commence la peinture directement par la copie de têtes peintes, sans préparation spécifique de l’œil à la couleur. Il propose donc ces exercices comme étape préparatoire à la peinture, permettant de :
renforcer l’œil,
fixer les impressions colorées,
assouvir l’envie de peindre tout en poursuivant l’étude du dessin.
« L’élève […] veut peindre prématurément. Le moyen que j’indique permettrait de l’y maintenir plus longtemps. »
Applications concrètes
Après avoir travaillé sur les cartes colorées, les élèves passent à :
des objets de nature morte,
des fragments de tableaux,
et même des paysages de mémoire : ciels, effets de lune, de soleil, etc.
« On a pu peindre de mémoire, avec une vérité d’impression très-remarquable, quelques horizons, effets de lune et de soleil observés rapidement sur nature. »
Utilité artistique et industrielle
La mémoire de la couleur est jugée essentielle à la peinture, mais aussi à de nombreuses industries décoratives : tapis, étoffes, papiers peints, décors de théâtre, etc.
« Le perfectionnement du sens de la couleur pourrait être utile dans une foule d’industries où le goût et l’élégance jouent un si grand rôle. »
Ouverture théorique
Enfin, Lecoq mentionne que cette éducation de la couleur pourrait servir de base concrète à des réflexions plus larges sur l’enseignement de la peinture, et même sur les lois de la perception, ouvrant la voie à des collaborations entre artistes et scientifiques (notamment Chevreul, qu’il cite).
« Il est facile de prévoir combien le perfectionnement du sens de la couleur pourrait être utile […] dans les combinaisons de nuances d’où résulte souvent tout un succès. »
Conclusion
Avec Éducation de la mémoire pittoresque, Horace Lecoq de Boisbaudran propose une méthode pédagogique audacieuse, rigoureuse et visionnaire. Bien avant l’essor des neurosciences ou de la psychologie cognitive, il pose les bases d’un entraînement méthodique de la mémoire visuelle, visant à former des artistes plus libres, plus puissants, plus observateurs.
Sa pensée ne s’arrête pas au cadre académique : elle propose une vision globale de la culture artistique, du goût, de la créativité, au cœur de la formation humaine.
« L’observation mnémonique […] forme et développe le goût et le sentiment du beau. »
Retrouvez cet ouvrage en téléchargement libre sur Internet archives